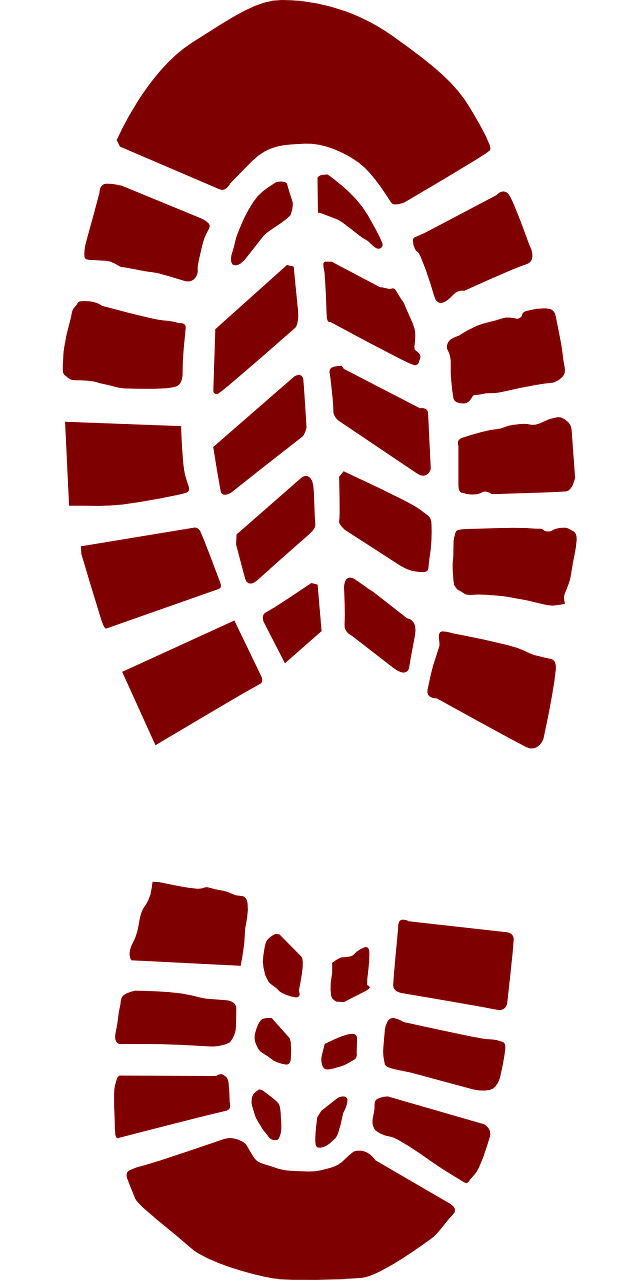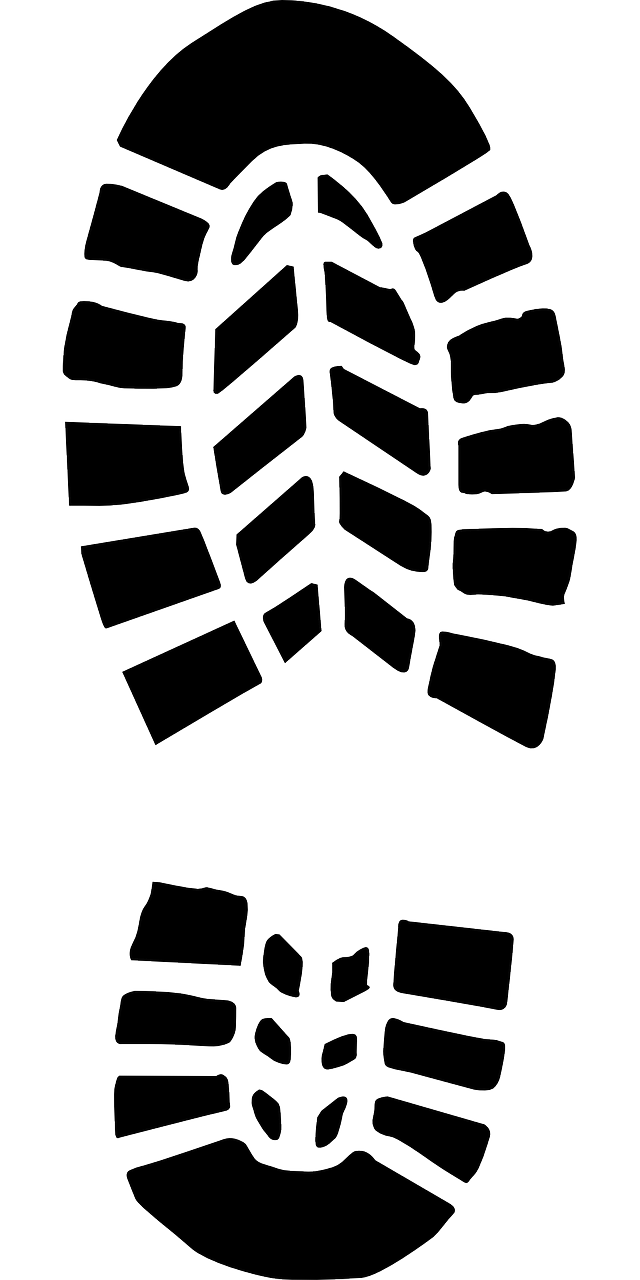|
EN BREF
|
Le bilan carbone des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a été évalué par le Commissariat général au développement durable. Malgré un résultat affichant 2,085 millions de tonnes d’équivalent CO2, moins que les éditions de Londres et Rio, ce bilan reste décevant au regard des ambitions initiales des organisateurs, qui espéraient atteindre une contribution positive pour le climat. Les transports ont constitué près des deux tiers de cette empreinte, mettant en lumière l’importance de leur optimisation. Moins de la moitié du bilan provient des activités de construction, grâce à une utilisation accrue d’infrastructures existantes. Néanmoins, les chiffres finaux montrent un décalage avec les promesses, illustrant les défis rencontrés pour concilier durabilité et rentabilité dans l’organisation d’événements d’envergure.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 ont suscité de nombreuses attentes en matière de développement durable. En effet, un rapport publié par le Commissariat général au développement durable (CGDD) révèle que, bien que les résultats soient meilleurs que ceux des précédentes éditions à Londres ou à Rio, ils demeurent inférieurs aux objectifs ambitieux fixés initialement. Ce bilan soulève des interrogations cruciales sur la façon dont les événements sportifs peuvent réellement minimiser leur impact environnemental.
Un bilan carbone évalué à 2,085 millions de tonnes équivalent CO2
Le rapport du CGDD indique que les JO de Paris généreront environ 2,085 millions de tonnes d’équivalent CO2. Ce chiffre est le résultat d’une analyse poussée effectuée en collaboration avec le cabinet d’audit EY. À titre de comparaison, les Jeux de Tokyo en 2020, organisés sans spectateurs, avaient également un bilan similaire. En revanche, les Jeux de Londres en 2012 avaient dégagé 3,3 millions de tonnes et ceux de Rio, en 2016, 3,6 millions de tonnes d’équivalent CO2. L’approche parisienne a valorisé les infrastructures existantes, limitant ainsi une partie des émissions de gaz à effet de serre.
Les transports et leur impact majeur sur l’empreinte carbone
Un des principaux facteurs contribuant à ce bilan carbone demeure le secteur des transports, représentant près des deux tiers de l’empreinte totale. Les déplacements des spectateurs, notamment ceux venant de l’étranger, constituent presque la moitié de ces émissions, soit 0,961 million de tonnes d’équivalent CO2. Les déplacements locaux dans la région, ajoutés à ces chiffres, représentent un impact supplémentaire de 0,041 million de tonnes.
Toutefois, des progrès notables ont été réalisés en matière de transport en commun, avec une meilleure desserte des sites et une utilisation accrue des mobilités douces. Près de 80% des spectateurs ont fait le choix de se déplacer par voie ferroviaire ou des modes de transport doux, comme la marche et le vélo, entraînant des résultats bien plus encourageants que la moyenne habituelle en Île-de-France.
Les secteurs de l’hébergement et des infrastructures
Le secteur de l’hébergement des visiteurs a également une part dans ce bilan, représentant environ 0,074 million de tonnes d’équivalent CO2. Il convient de noter que l’Île-de-France a enregistré un afflux moins important de touristes étrangers pendant l’été 2024 par rapport à l’année précédente, ce qui a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à cette activité.
D’autre part, les activités de préparation et d’organisation des Jeux ont contribué à une part de 16% du total des émissions, soit environ 0,327 million de tonnes CO2. La rénovation ou la construction d’infrastructures, comme le Stade de France et le village des athlètes, a engendré 19% des émissions, un résultat significativement inférieur aux précédentes éditions. En effet, à Londres, ce volet avait représenté près des deux tiers du bilan carbone.
Vers une utilisation plus responsable des matériaux
Une des avancées notables dans cette édition parisienne est liée à l’utilisation de matériaux bas carbone, permettant de réduire l’empreinte des constructions de près de 30% par rapport aux standards précédents. Le choix de privilégier des infrastructures temporaires et de recourir à une gestion rigoureuse des ressources a contribué à améliorer le bilan écologique global des événements.
Le CGDD souligne que la France bénéficie d’atouts structurels appréciables, tels que l’accès aux réseaux ferroviaires européens, permettant ainsi de diminuer les émissions liées aux transports. De plus, il est mentionné que la consommation d’énergie à Paris était semblable à celle de Londres tout en émettant près de huit fois moins de GES.
Un bilan inférieur aux ambitions initiales
Malgré ces avancées, le bilan carbone final demeure inférieur aux attentes initialement fixées par les organisateurs. En 2021, l’objectif était de concevoir les premiers Jeux à contribution positive pour le climat, mais deux ans plus tard, l’objectif a été réduit à 1,58 million de tonnes, dépassé de 505,000 tonnes par ordre final.
Des contradictions conceptuelles émergent alors dans l’organisation de tels événements : minimiser l’impact environnemental tout en maximisant les retombées économiques et l’affluence touristique. Des facteurs tels que le choix des lieux d’accueil et la capacité d’accueil des infrastructures jouent un rôle clé dans la détermination du bilan carbone global.
Optimiser le public international : une solution envisageable
Une des solutions envisagées pourrait impliquer une réévaluation de la stratégie de billetterie, avec un ciblage renforcé sur les spectateurs européens. En réduisant la part des spectateurs extra-européens à 5%, les émissions auraient pu diminuer potentiellement de 13%. Inversement, accepter une proportion plus élevée aurait entraîné une augmentation des émissions de 19%.
Les auteurs du rapport émettent le souhait que les leçons tirées de cette édition parisienne soient intégrées dans l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de 2030 dans les Alpes, afin de promouvoir une approche plus durable et responsable face aux défis environnementaux croissants.
Conclusion et perspectives d’avenir
Les résultats des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, tout en étant meilleurs que ceux des éditions précédentes, soulèvent de nombreuses questions sur l’avenir des événements sportifs. Il est impératif que les organisateurs prennent en compte ces enseignements pour assurer la durabilité des futures manifestations. La lutte contre le changement climatique nécessite une collaboration solide et une volonté politique affirmée pour véhiculer des changements structurels dans l’organisation des événements à grande échelle.
Pour plus d’informations concernant le bilan carbone et son évaluation au service du développement durable, consultez le lien suivant : bilan carbone. Les réflexions autour de l’impact du bilan carbone sur nos choix doivent continuer à être nourries par des analyses et des études telles que celle réalisée par François Bayeux dans sa publication accessible ici : étude.
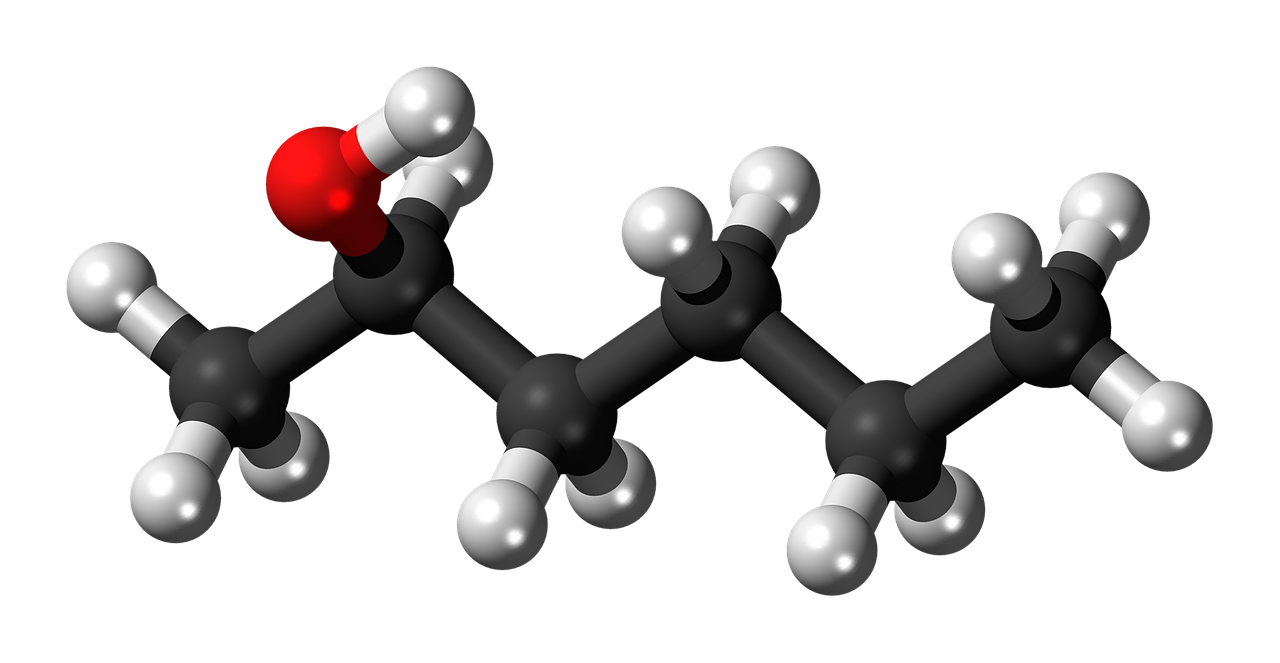
Témoignages sur le bilan carbone des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont suscité de nombreuses attentes en matière de durabilité et d’impact écologique. Toutefois, le bilan final, bien qu’amélioré par rapport aux éditions précédentes, laisse un goût amer chez certains acteurs. Selon un responsable d’une ONG environnementale, « le résultat de 2,085 millions de tonnes équivalent CO2 représente une avancée, mais il reste insuffisant pour répondre aux enjeux climatiques actuels. Les ambitions initiales des organisateurs fixées à une empreinte carbone positive semblent désormais très loin. »
Un membre du comité d’organisation a reconnu l’importance de l’impact des transports, affirmant : « Nous avons fait des progrès en matière de mobilité durable. Près de 80 % des visiteurs ont opté pour les transports en commun ou d’autres formes de mobilité douce. Cependant, les émissions liées aux déplacements restent très préoccupantes, surtout celles des spectateurs venus de l’étranger, représentant presque la moitié du total. »
D’autre part, un urbaniste a souligné les défis liés à la construction des infrastructures. « L’utilisation de matériaux moins carbonés et l’exploitation d’installations existantes étaient des choix judicieux. Néanmoins, il est alarmant que la préparation et l’organisation des Jeux aient rejeté davantage de gaz à effet de serre qu’anticipé. Cela montre qu’il reste encore beaucoup à faire pour aligner nos ambitions avec la réalité actuelle ».
Un technicien en développement durable a quant à lui noté que malgré les améliorations, « le bilan est en deçà des attentes. En 2021, les promesses d’un événement climatiquement positif se sont progressivement transformées en une quête de réduction plus qu’un véritable changement de paradigme. Nous devons apprendre de cette expérience pour les futurs grands événements sportifs ».
Enfin, une des personnes interviewées a observé une déconnexion entre les messages et les résultats. « Ce n’est pas seulement le chiffre qui dérange, c’est l’écart entre la communication sur les objectifs et la réalité des émissions de GES. La question n’est pas de comparer Paris à Londres ou Rio, mais de se demander si nous faisons réellement assez pour notre planète. »